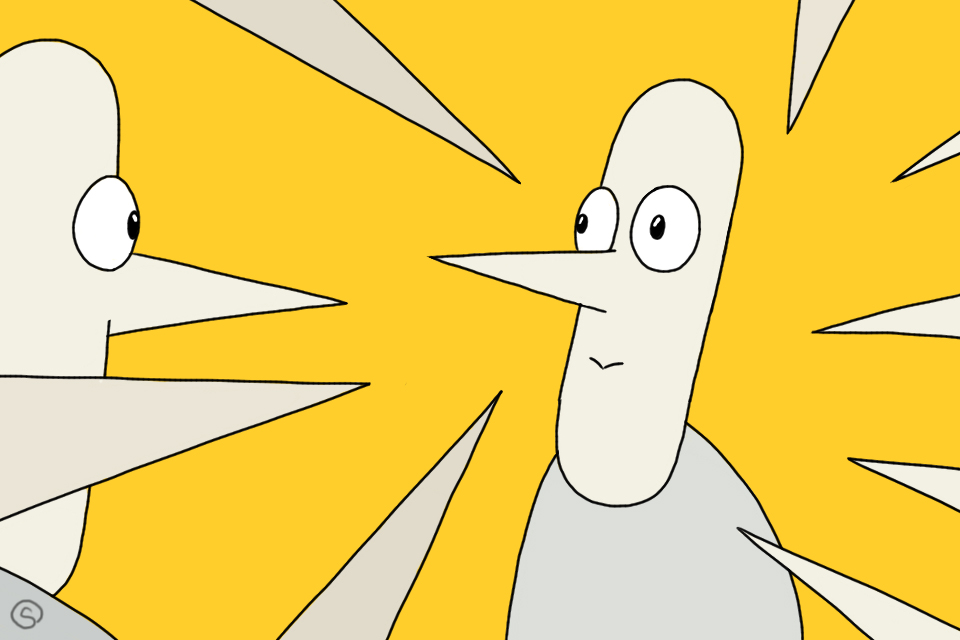ANTONIO NEGRI.
« Nation » a longtemps été un concept difficilement définissable hors de cet autre concept qu’était l’État-nation. Aujourd’hui, les choses sont bien différentes.
Mais commençons par le commencement, donc précisément par le concept d’État-nation. Deux éléments lui donnaient forme : le premier, politique et juridique, était celui de l’État ; le second, historique, ethnique et culturel, était le concept de nation. Cependant, c’est à partir du concept d’État-nation que la nation est devenue une réalité, que la force souveraine a donné naissance à la nation. Quand on parle de nation, il faut toujours avoir en tête cette genèse. Dans tous les cas, la « nation » est un concept dont il a été proposé des critères de définition variés, avec différentes racines idéologiques. Normalement, on essaie de le saisir sous trois points de vue.
Premièrement: une catégorie qui comprend les données naturelles, par exemple l’élément ethnique (la population) et l’élément géographique (le territoire). L’élément ethnique a parfois té relié à l’idée de race, même si le concept de race ne donne lieu que rarement, parmi les théoriciens de la nation, à une application biologique. Quand cela a été le cas, il s’est agi – pas seulement dans le cas ignoble du nazisme – d’opérations politiques dénuées de tout fondement scientifique, toujours terroristes, destructrices et agressives.
La seconde catégorie comprend les facteurs culturels, comme la langue, la culture, la religion, et/ou la continuité de l’État. Dans certains cas, il peut y avoir des liens étroits entre de la première et de la seconde catégorie : le critère ethnique et le critère linguistique peuvent par exemple être confondus, comme aussi le critère politique et le critère religieux.
Une troisième catégorie d’éléments de définition comprend les facteurs subjectifs : la conscience, la volonté, le sentiment national. Sur la base de ces critères, le concept de nation ne trouve pas son fondement dans quelque chose de prédéfini mais au contraire dans un acte de volonté plus ou moins déterminable, de la part des membres de la population – et cela constitue la nation elle-même. Ernest Renan définit alors en ce sens la nation comme un « plébiscite de tous les jours ».
D’autres auteurs ont établi une classification sur la base d’une opposition entre deux critères fondamentaux : un mode « naturaliste » et un mode « volontariste ». Souvent, le « naturalisme » est attribué à des penseurs allemands, alors que le « volontarisme » est qualifié presque comme un « cliché » français… Mais la distinction est bien entendu très incertaine – il suffirait de se rappeler que Fichte, dans ses Reden and die Deutsche Nation, qualifie la nation comme acte de conscience et de volonté, et non pas de nature.
Que dire, alors ? Si l’on s’en tient à la vieille définition de l’État-nation, il est absolument évident que le concept de nation possède un caractère complexe, ambigu, et difficilement déterminable : les critères proposés non seulement s’opposent les uns les autres, mais souvent ils se superposent ; et même quand la définition du concept de nation veut être complète et précise, elle doit fatalement éviter ou ignorer la multiplicité des différences et des conditions historiques dont la nation est pourtant issue. Finissons en ajoutant que les doctrines de la nation n’ont jamais réussi a déterminer de manière précise le concept de réalité nationale et celui de comportement national.
Il n’y a qu’en partant de l’examen du développement historique du concept de nation que l’on peut arriver directement au cœur du problème – le problème du rapport entre État et nation. Et il faut reconnaître que ce sont surtout les grandes unifications nationales du XIXe siècle (l’Allemagne, l’Italie, etc…) qui ont mis en évidence un processus qui tentait de faire coïncider la nation avec l’État. C’est à travers cette identification que la nation a été considérée pendant longtemps comme un concept central des doctrines politiques. Il suffirait ici de faire référence aux écoles historiographiques qui ont été dominantes dans tous les pays européens ; mais pas seulement : le droit – privé et publique – est devenu au XIXe siècle une émanation de l’État-nation, et toutes les conceptions antagonistes, qui étaient pourtant fréquentes, ont été réduites au silence.
Entre le XIXe et le XXe siècles, das Volk, the People, la Nation ont pour ainsi dire imposé aux biopolitiques leur dictature.
Il faut aussi remarquer que la fusion entre les concepts de nation et d’État n’aurait pas été suffisante pour obtenir l’adhésion des citoyens et à en légitimer l’obéissance – surtout dans les « états d’exception et de nécessité » -, si cette fusion n’avait pas elle-même été traversée par la référence à la patrie. – une notion aux origines très anciennes, avec une longue histoire derrière elle, et dotée d’une lourde charge émotive. Si la nation est le fruit des circonstances, et que l’État est une institution conventionnelle, la patrie est au contraire le résultat d’un choix – et c’est ce choix, ce jugement de valeur qui a probablement produit entre le XVIII et le XIX siècles la connexion culturelle entre les deux autres concepts , l’État et la nation. La nation devient une patrie, et l’État, l’appareil tout à la fois de force et de droit dans lequel s’affirme et s’organise la nation, polarise sur soi l’amour et le dévouement réservés à la patrie, ce bien suprême. IL est assez clair que dans cette fusion jouent des échos rousseauistes, et plus encore, nous allons le voir, des sonorités romantiques. Les caractéristiques de l’unification des concepts d’État et de nation chez Hegel sont en revanche bien moins poétiques. L’État chez Hegel n’est pas une construction abstraite : il émerge à travers la reconnaissance d’un donné économique et social (la société civile) et l’affirmation du principe national considéré comme acteur de l’histoire. Hegel est le vrai théoricien de l’État moderne parce que, en allant au-delà de ce qu’on pensé les théoriciens de la souveraineté des XVIe et XVII siècles et des théoriciens de la société civile du XVIIIe siècle, il considère le facteur de la nationalité comme prépondérant.
Il est évident que ce que je dis est réducteur par rapport aux dimensions du phénomène « nation », et je m’en excuse. Mais la réduction que j’opère ici ne cherche pas à avoir des effets mystificateurs : le concept de nation est toujours contradictoire, il exalte les valeurs qu’il impose, joint à l’amour le despotisme. Et il accorde au sujet la citoyenneté seulement si celle-ci est aussi accompagnée d’aliénation et de sujétion. Même quand la dimension patriotique du concept est considérée comme centrale, les contradictions demeurent – nous avons de ce point de vue un texte formidable, Pro Patria mori in Medieval Political Thought, d’Ernst H. Kantorowicz. Selon Kantorowicz, on trouve à l’intérieur de la notion de patrie deux tensions opposées qui y vivent et sont unifiées dès l’époque médiévale. D’une part, le sentiment de vivre dans la nation, politiquement, patriotiquement, comme si l’on était dans un « corps mystique » ; et avec cela, l’idée que cette adhésion peut et doit produire des conduites et des conséquences sociales. « Ceux qui déclarent la guerre au saint royaume de France déclarent la guerre au roi Jésus » Mais d’un autre côté, quand l’État séculier exalte à travers le concept de patrie sa souveraineté et son pouvoir, il impose aussi au citoyen une obéissance qui est sacrifice, une identité qui le rend généreusement disponible pour l’État. Les deux dimensions de l’État-nation se retrouvent par conséquent dans sa généalogie, et dans le concept de patrie.
Revenons à ce qui nous intéresse. L’État-nation a donc été la grande réalité politique produite par le XIXe siècle, le fruit d’un processus historique complexe et hétérogène qui a été redoublé par une élaboration théorique tout aussi complexe et hétérogène. Le développement des principaux courants politiques qui se sont affrontés en Europe jusqu’au début du XXe siècle a été très fortement conditionné par cette réalité imposante – et ce conditionnement émerge à travers la médiation générale que les théories politiques, libérales socialistes chrétiennes, ont construit à l’égard du concept de nation. De ce point de vue, il serait par exemple intéressant de remarquer à quel point l’idéologie et la pratique politiques du socialisme ont balancé entre internationalisme et patriotisme, entre cosmopolitisme et nationalisme.
Avant d’en arriver à la crise actuelle, et peut-être de discuter du réveil de l’idée de nation, il faut que nous définissions d’autres éléments qui sont inclus dans la conception que le XIX et le XXe siècles ont eus de celle-ci, et qi viennent compléter sa définition originaire. En effet, on ne peut pas comprendre la réalité de l’État-nation si nous ne plongions pas son concept dans l’histoire du capitalisme moderne. Bien entendu, il ne s’agit pas d’oublier que, dans certains États européens, la constitution de la nation ait été antérieure à la naissance du capitalisme – mais cette construction de la nation, produite par des monarchies absolues comme en Grande Bretagne, en France et en Espagne, change radicalement quand elle est confrontée aux caractéristiques qui seront plus tard – et pour tous – accrochées à l’identité ethnique et culturelle de la nation dans le contexte du développement capitaliste. L’État-nation n’a pas une seule âme (pour ainsi dire – et au-delà de toute ambiguïté) qui serait idéale, liée au patriotisme et aux passions de l’identité. Il possède aussi une âme que l’on pourrait appeler matérialiste – dans laquelle l’identité et le patriotisme trouent souvent leur expression à travers l’égoïsme et l’agressivité à l’égard d’autrui. L’État-nation moderne, il ne faut pas l’oublier, naît du romantisme, comme une lutte contre le jacobinisme révolutionnaire et l’expansionnisme napoléonien, contre les Lumières révolutionnaires (et leur dérive) ; mieux encore : il traduit l’affirmation de l’identité nationale en un principe « réactionnaire » par rapport à l’universalisme, c’est-à-dire en un principe de différence, et souvent d’exclusion, pour tous ceux qui, du point de vue du sol ou du point de vue du sang, n’en font pas partie. Il faudrait ici se souvenir de l’évolution du jeune Hegel – parmi tant d’autres sans doute, puisqu’il adhéra au jacobinisme révolutionnaire français, puis qu’il passa à la conscience de ce que « l’Allemagne n’a pas de métaphysique » (en cherchant à dire par là que l’Allemagne n’avait pas un État unitaire souverain). Cette idée se développe par la site dans la pensée hégélienne de la maturité à travers la construction d’une dialectique entre l’économique et le politique, entre l’instance capitaliste et l’instance souveraine, qui devient décisive pour la construction du Reich allemand et de la puissance capitaliste allemande.
C’est sur cette base que l’État-nation se lie étroitement au développement du capitalisme. Les grands États souverains de la modernité – la Grande Bretagne et la France – avaient, comme je l’ai rappelé, déjà donné lieu à l’accumulation primitive du capital ; ils avaient aussi renversé les résistances de la dimension commune et des usages agraires pré-capitalistes en favorisant les processus d’accumulation manufacturière. Mais, bien au-delà de ce qu’ont été cette expropriation des commons et de l’accumulation primitive, ce n’est que dans le cadre de l’État-nation moderne que des formes juridiques, administratives et politiques adaptées à la stabilisation de la croissance capitaliste et à la formation de l’État bourgeois s’organisent. En bref : l’âme contre-révolutionnaire et anti-illuministe qui avait été à la base de la formation des idéologies et de la plus récente formation de l’État-nation, cette âme, donc, sous la poussée du développement capitaliste, s’incarnera dans des figures qui n’étaient peut-être pas nécessairement très prévisibles au départ, mais qui ont été très rapidement considérées comme fondamentales dans l’exercice du pouvoir étatique et dans le développement du pouvoir économique « de classe ». Ces figures ont également été décisives pour maintenir l’unité de la nation face aux difficultés de l’accumulation et aux déchaînements de la lutte des classes. C’est dans cette situation que l’État-nation européen libère pleinement sa propre vocation. J’entends par là : les figures de la conquête coloniale, les pratiques de l’agression impérialiste, les productions idéologiques fascistes, pour arriver finalement jusqu’à la production de monstrueuses machineries de guerre auxquelles ont a voulu lier l’existence même de la nation.
« L’amour de la patrie » – jamais l’expression n’a sans doute été plus appropriée – nous empêche de suivre ce fil jusqu’au bout et de décrire soigneusement les résultats, mieux encore, les dérives terribles, de ce développement. La barbarie du colonialisme est bien connue ; la violence des conquêtes et des agressions impérialistes, de temps en temps, resurgit et réapparaît sur le fond de notre actualité ; mais c’est sur les fascismes et sur les délires impérialistes que notre attention doit se concentrer : sur les millions de morts que les guerres du XXe siècle ont laissé derrière elles. Est-ce que c’est là que le concept de patrie et celui de nation prennent congé l’un de l’autre de manière définitive ? Que les passions liées à l’amour pour le voisinage et pour cette espèce de famille élargie que, pour chacun de nous, son propre pays représente, n’arrive plus à se reconnaître dans les aventures et dans les structures de l’État-nation ? Peut-être. Ce qui est sûr, c’est qu’à ce moment là, une nouvelle histoire du concept commence. Sans doute une nouvelle manière de se considérer comme des citoyens est née. Citoyens du monde ? Encore une fois : peut-être. Certains se plaignent aujourd’hui de ce que le concept de nation ait été bouleversé et pour ainsi dire renversé par les structures du marché mondialisé. Mais la transition de l’économie internationale – une économie fondée sur les États-nations et sur leur interaction dans le marché mondial – à une économie mondialisée dont le capital est capable de fonctionner à un niveau planétaire, et qui réduit les États-nations au rôle de simples articulations du pouvoir mondial, ce tournant, donc, doit être considéré comme heureux. Il est heureux, si l’on compare les nouvelles conditions dans lesquelles les hommes vivent dans ce contexte globalisé aux conditions qui étaient les leurs quand les nations se massacraient entre elles.
Nous n’avons pas l’illusion que ces nouvelles conditions éliminent les désaccords entre les peuples et qu’elles mettent fin aux guerres. Nous voyons bien que les violences provoquées par les nationalismes sont peu à peu remplacées par des violences encore plus féroces, enracinées dans la haine religieuse et l’injonction sacrale, et qu’il faut constater des retours de racisme à l’intérieur et l’extérieur des communautés nationales, y compris ici, en Europe. Bie sûr : tout cela est terrible. Mais quelque part dans notre conscience, nous sentons que, au-delà de ces épisodes, un monde dans lequel de telles horreurs seront impossibles nous attend. Le capitalisme a créé la mondialisation ; désormais il s’agit de construire à un niveau mondial une société démocratique.
Mais reprenons l’étude des caractéristiques de la référence à l’État-nation, qui reviennent à nouveau. L’État-nation a été un concept « centripète » : la nation offrait en effet au gouvernement, à une fonction centralisée de commandement, un caractère absolu qui garantissait le passage de la décision à l’exécution des actes du gouvernement. Kantorowicz est très clair : il y a deux corps du gouvernement. Le premier est la fonction royale, la souveraineté, la nation, il préside à la définition du caractère absolu du pouvoir souverain, c’est la monarchie. Le second corps vit et meurt, c’est la contingence et la discontinuité du gouvernement, de la représentation politique, les arrêts et les interruptions historiques de la vie des États – mais ce caractère « mortel » est traversé par l’effet souverain, qui en garantit l’immunité et en empêche la décadence. Ces deux corps, ces deux fonctions du pouvoir, aujourd’hui, dans le monde contemporain, se sont étiolées et tendent à se dissoudre au moins en partie.
Mai le concept d’État-nation ne disparaît pas simplement à cause de la transition d’une économie mondiale à une économie mondialisée qui serait, elle, caractérisée par une interconnexion financière à l’échelle planétaire. La décadence de l’État-nation a été accompagnée par une autre transition, celle qui a fait passer du gouvernement à la governance – une transition qui indique l’hybridation entre le publique étatique et le privé du marché, mais qui surtout révèle, parmi tous les aspects du caractère juridique du marché, la dimension réelle des échanges globaux. Cette transformation défie l’unité des systèmes de légitimation de l’État-nation, du droit international privé et publique, elle en émousse la capacité de gouvernement et réinscrit à un niveau global les figures et les fonctions des organes de régulation capitaliste.
On pourrait alors se demander, bien au-delà de toutes les idéologies et de toutes les historiographies bénies par la nation elle-même, si la genèse et la composition des États-nations, leur réalité historique, ne doivent pas à leur tour être renvoyées non pas tant à une origine qui se serait transformée en telos et se serait ainsi réalisée, mais à une sorte de « pot-pourri » constituant indéfini – à un nœud de rencontres/affrontements entre des populations, des groupes et des formes de gouvernement différents ; à des dynamiques contradictoires impliquant des fractions capitalistes, des manèges aristocratiques, des soulèvements démocratiques ; au développement discontinu de stratégies néo-mercantilistes, de manipulations fiscales et douanières, etc. Et encore, pour certains États-nations plus périphériques, aux conséquences et aux dérives des mouvements coloniaux et des stratégies impérialistes – et surtout aux mouvements de population qui en sont déterminés. Et, pour finir, aujourd’hui, aux modes de communication et de transport, à la porosité et à la plasticité des frontières, etc. Toutes les déterminations non seulement naturalistes mais culturelles de l’État-nation semblent de fait se dissoudre dans ces soubresauts et ces transformations.
Est-ce que vous n’avez pas l’impression, alors que nous décrivons si rapidement l’histoire du concept d’État-nation, qu’il s’agit en réalité de quelque chose d’artificiel et de précaire, de quelque chose qui appartient désormais à une sphère archaïque ? Que, envisagé du point de vue de sa genèse, c’est quelque chose qui tient du hasard, de la précarité et de l’incertitude ? Et qu’au-delà de cette genèse, quand on parle du déclin de l’État-nation moderne, quand on parle des délires fascistes et des millions de victimes des guerres, de la violence et de la haine, que le concept de nation est simplement devenu l’emblème d’une histoire terrifiante, presque la marque d’un refoulement radical ? Et que e concept de patrie lui aussi possède des aspects pervers ? Je ne pense pas que chacun d’entre nous puisse donner une réponse tranquille à cette question. Mais si nous réussissons à refuser cum ira et studio de nous reconnaître dans cette identité, nous réussirons aussi à nous reconnaître dans un monde différent. Dans un instant, il s’agira de discuter des aventures de cette nouvelle existence post-moderne. Mais si, pour l’instant, nous regardons en arrière, nous pourrons cependant conclure à présent en disant de l’État-nation ce qui fut dit de la fin de l’Empire romain : sur le modèle de « latifundia detruere imperium » – le latifundium détruisit l’empire – aujourd’hui, « les États-nations ont détruit la souveraineté moderne ».
A présent, essayons de raisonner sur cette pincée de « nationalité » (j’entends par ce mot le reflet pâle et nostalgique du sentiment national situé dans l’idéologie) qui réapparaît aujourd’hui dans les événements qui nous entourent, et surtout dans les conflits entre les protagonistes de l’ordre mondialisé. Ce sont, me semble-t-il, des remontées d’égoïsme qui cherchent une dignité dans la mémoire, mieux encore dans la nostalgie de l’histoire nationale. Elles trouvent un espace propice dans la crise que la mondialisation est en train de traverser. A la fin du XXe siècle, après la chute du mur de Berlin et la fin du dualisme des histoires d’Occident et d’Orient, la mondialisation s’accompagna d’un effort important pour reconstruire de nouveaux systèmes juridiques et politiques au niveau planétaire. L’échec des élites globales pour construire un nouvel ordre a cependant été retentissant. Nous en mesurons aujourd’hui les conséquences – et ce sont ces conséquences qui se montrent dans la crise des marchés, dans la chute de la production mondiale, dans les incertitudes monétaires, dans la difficulté à contrôler les mouvements de la finance… Qui aurait pu prévoir que les conséquences de nouvel ordre, que tous saluaient avec tant de bonheur à la chute du Mur, auraient été de cette nature ?
Il s’en est suivi une dangereuse absence de clarté dans les rapports internationaux, et une série de désaccords, de conflits et d’incompréhensions entre ses acteurs : tout cela rend difficile de s’orienter. A l’unité de l’ordre mondialisé (échanges marchands et financiers) ont fait suite des ruptures et des tentatives de reconfiguration de ce même paysage mondialisé – plus à travers les États –nations en eux-mêmes, mais par le rapport entre des structures continentales. A l’Amérique du Nord, à la Chine, à l’Europe en devenir, à l’Amérique latine, à l’Inde – qui conservent une certaine solidité géopolitique -, correspondent dans la crise des bases régulées par le soft power américain de véritables cataclysmes politiques. Et désormais le mouvement d’une partie de la planète détermine – positivement ou négativement, selon les cas – celui de tous les autres éléments du système mondialisé.
Dans la crise du système global émerge par ailleurs, avec une grande violence, la crise de l’accumulation capitaliste et du développement des institutions démocratiques. A la dimension macro répond la dimension micro, et inversement. La géopolitique et les crises industrielles et financières, les inégalités croissantes des systèmes sociaux, etc., se renvoient les uns les autres les causes et les effets. Nous pourrions continuer longtemps cette description de la crise actuelle dans sa dimension globale, à la fois intérieure et extérieure aux États. Ces premières caractéristiques que je viens de souligner suffisent, me semble-t-il, pour comprendre les raisons pour lesquelles, dans de nombreux pays, l’exigence d’un retour à des politiques nationales, de refaire à nouveau de l’État-nation le point d’imputation et de responsabilité du développement, se présentent avec force sur le devant de la scène.
Mais la nostalgie de l’État-nation est inutile, et elle est dangereuse : la dimension globale dans laquelle le capitalisme s’est organisé constitue un cadre fixe pour le mouvement de toutes les institutions, quelles qu’elles soient – étatiques ou politiques, industrielles ou financières. Celles-ci agissent sur le terrain global et ont des difficultés énormes à revenir à l’intérieur d’un cadre national. Un retour en arrière par rapport à la mondialisation est impossible, même si le chaos semble en déterminer la forme. Par ailleurs : chaque fois que ces identités nationales réapparaissent, souvent elles le font en se confondant avec des idéologies et des pratiques religieuses et fanatiques. Le patriotisme, qui était une religion laïque, s’est transformé en idolâtrie raciale ou en fanatisme religieux. Si, dans son histoire, le nationalisme a eu des moments créatifs et a donné lieu à la fusion de peuples et de personnes différentes, si le concept de nation a dans certains cas mobilisé des passions généreuses et un noble sens de la liberté, aujourd’hui, le concept de nation se présente sous une autre forme : plein de rancœur, parce que le retour au passé est difficile et parfois impossible, et parce que cette impuissance se retourne contre des adversaires factices et imaginaires – des ennemis auxquels est attribuée la cause des difficultés actuelles. Le populisme est la forme dans laquelle ces sentiments durs et plains de haine se présentent. Il ne menace pas seulement l’ordre international mais très évidemment aussi la forme démocratique du gouvernement. On veut transformer la démocratie et la transformer, la reconstruire à partir d’une règle nationale que l’on considère comme juste ? Mais comment peut-on oublier les inégalités, les divisions de classe, les vicissitudes d’une règle nationale toujours exposée à la guerre ? Aujourd’hui, parce qu’elle renonce à l’utopie d’un ordre international dans le sillage de la mondialisation, et à celle d’un ordre démocratique dans le sillage de l’internationalisme démocratique, l’idée de nation nous expose simplement à la risée.
Mais passons à présent à un dernier problème. La crise du capitalise tardif et mondialisé existe, on ne peut bien entendu pas mettre cela en doute. Elle se déroule devant nos yeux depuis quelques années. Et nous ne pouvons pas douter non plus de ses conséquences, qui seront encore durables. Est-ce que nous pouvons en conclure que si la mondialisation a représenté le triomphe du capitalisme, elle en est aussi la maladie ? Une maladie létale ? Je ne crois pas que nous puissions répondre en termes aussi définitifs et assertifs. Ce qui semble évident, c’est que la crise s’est instaurée précisément là où le pouvoir capitaliste s’était affirmé avec la plus grande détermination, c’est-à-dire sur ce niveau d’abstraction du pouvoir, de distance à l’égard des mouvements citoyens qui semblait avoir rendu le capital global définitivement autonome dans sa puissance – et hors de portée des éventuelles résistances qui se seraient éventuellement opposées à lui. Mais cette autonomie et cette consistance qui sont les siennes deviennent toujours plus pauvres – pauvres de valeurs, incapables de progrès, aveugles par rapport à la détérioration des conditions de développement, insensibles aux poussées vitales et aux innovations coopératives. Il est intéressant (et symboliquement passionnant) de remarquer que la crise financière – qui est liée aux effets de l’organisation de l’ordre du capital financier – se développe essentiellement sur un terrain monétaire. Oui, précisément cette monnaie qui était si liée à l’imaginaire national. Mais il est sans doute plus intéressant encore de constater que la crise de la monnaie en question répond à un fonctionnement global. On ne peut donc en aucun cas se protéger de la crise en se cachant derrière sa propre monnaie nationale – on risquerait purement et simplement la catastrophe.
Ma conclusion est donc que nous ne pourrons pas échapper à la mondialisation. Et que sans doute la seule voie de salut, qui nous permettrait aussi d’être libres, serait celle d’un exode démocratique hors de l’État-nation. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que si nous tenons à tout ce que, dans la nation, nous pouvons considérer comme positif et créatif, si nous tenons à sa langue et à sa littérature – si elle en possède une -, ou à sa mémoire et à son imagination – si cela en vaut la peine -, ou encore à ses paysages, à l’odeur de sa terre et à ses reliefs, qui sont parfois les choses les plus chères que nous ayons – si nous tenons à tout cela, et à tant d’autres choses encore, il faudra renoncer à faire de la nation un État. Comment est-ce que cela peut être possible ? Je ne sais pas.
Pourtant, ces derniers jours, j’ai eu entre les mains le livre d’un anthropologue de l’université de Yale, James C. Scott – un livre récent dont le titre est Zomia. The Art of Not Being Governed. « Zomia » est le terme employé par James C. Scott pour désigner tous les territoires qui se trouvent à une altitude supérieure à 300 mètres, qui traversent 5 pays (Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et la Birmanie) et cinq provinces de la Chine, et qui vont des hautes vallées du Vietnam aux régions du nord-est indien. Ce sont là à peu près 100 millions de personnes, qui appartiennent à des minorités ethniques et linguistiques d’une variété absolument « sidérante ». Bien : ces populations ne sont pas, comme voudraient pourtant les considérer les segments d’États-nations qui les effleurent marginalement, des sortes de multitudes sui ne seraient pas encore devenues des peuples. Ce sont des multitudes, oui, mais qui ont précisément fui cette possibilité, qui se sont soustraites aux différentes formes d’oppression qu’on leur proposait. La construction de l’État-nation dans les vallées sous le territoire de Zomia signifiait l’esclavage, la conscription (c’est-à-dire le service militaire obligatoire), les impôts, les épidémies, les guerres. Ils ont fui tout cela. La crise de l’État-nation nous offre-t-elle, à nous, comme seule voie de salut cette même fuite que certaines populations, précisément au moment de la naissance de l’État-nation, ont choisie ? Sans doute n’est-ce pas la bonne solution, ou en tout cas pas sous cette forme. Mais les problèmes que nous devons affronter, nous n’en sommes pas les responsables. Et quand ces problèmes se posent, il faut bien tâtonner pour tenter d’inventer : non pas un retour en arrière mais une expérimentation nouvelle.